Par Anne Sophie PERRRISSIN FABERT - Directrice de l'association HQE
La nouvelle Réglementation thermique (RT 2012), qui généralise les bâtiments basse consommation, change aussi la donne. En effet, pour continuer à être plus ambitieux, il est à présent nécessaire de s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et à d'autres enjeux environnementaux et de santé.
Fin 2010, l'Association HQE a lancé le test "HQE Performance" pour les bâtiments neufs basse consommation en démarche HQE, sur deux thématiques du futur cadre de référence : d'une part l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments par la réalisation d'analyse de cycle de vie (ACV) bâtiment, et d'autre part, la mesure de la qualité de l'air intérieur. Elle avait ainsi pour but de faire progresser la connaissance sur ces sujets et d'acquérir une première idée d'ordre de grandeur des valeurs repères pour les indicateurs environnementaux.
Cette chronique présente les résultats les plus marquants de ce test.
L'évaluation "grandeur nature" par une analyse de cycle de vie (ACV ) de 74 bâtiments - représentant 800 logements et 300 000 m² de surfaces tertiaires - est une première mondiale.
Cycle de vie du bâtiment
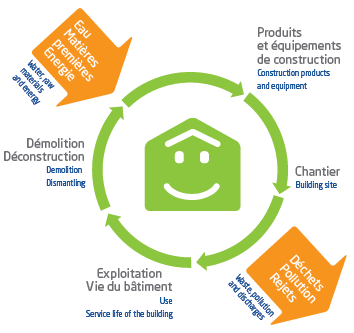
74 bâtiments neufs étudiés
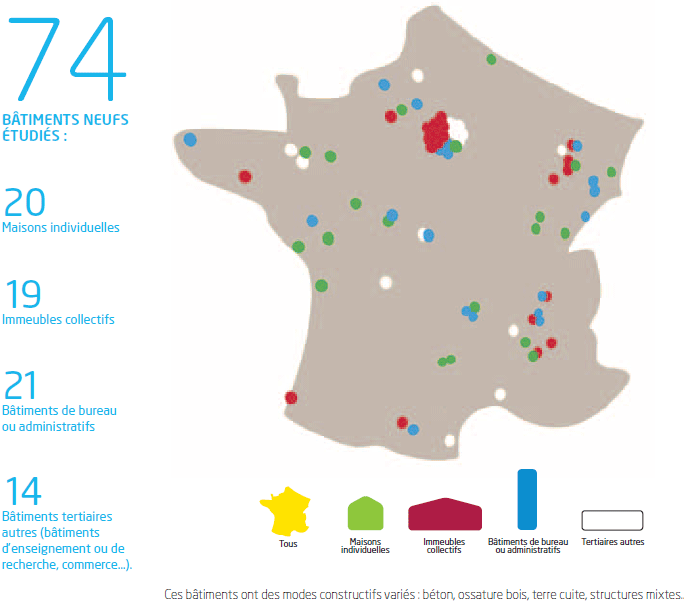
La RT 2012 changeant la donne avec une consommation énergétique des bâtiments considérablement réduite, l'étude l'a anticipée en ne retenant que des Bâtiments Basse Consommation (BBC) inscrits dans une démarche HQE pour la plupart certifiés.
Pour faciliter la capitalisation des informations, le test a eu recours à un seul logiciel d'ACV bâtiment, le logiciel Elodie développé par le CSTB, partenaire de l'opération.
Dans cette étude, les impacts environnementaux ont été calculés pour le bâtiment sur les contributeurs suivants :
- produits et équipements de construction,
- consommation énergétique réglementée,
- consommation énergétique non réglementée,
- consommation et rejets d'eau.
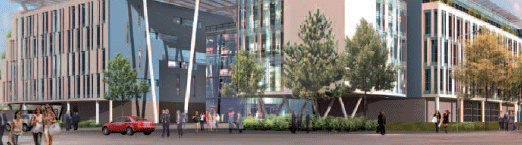
Les résultats présentés dans les pages suivantes sont calculés pour une durée de vie conventionnelle de l'ouvrage de 100 ans. Cette durée de vie conventionnelle ne correspond pas à celle de l'utilisateur ni à celle de l'investisseur.
La structure des ouvrages est le plus souvent calculée pour cette durée de 100 ans, ce qui n'empêchera pas beaucoup d'entre eux d'avoir une durée de vie plus longue comme en témoignent tous ces bâtiments qui font la richesse de notre patrimoine.
À noter :
La conversion énergie primaire/énergie finale dans la réglementation thermique et en ACV bâtiment se fait sur des bases différentes. Ainsi, ces ratios, conventionnellement fixés dans la RT à 2,58 pour l'électricité et 1 pour les énergies fossiles, deviennent dans les ACV des valeurs plus proches de 3,13 pour l'électricité et de 1,0 à 1,18 pour les énergies fossiles.
C'est pourquoi le BBC-Effinergie de 50kWh/m²/an est égal à 60,66 kWh/m²/an avec les ratios ACV.
Principes d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments
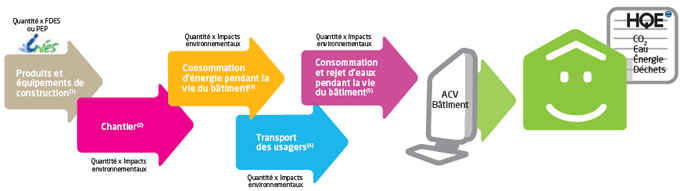
Consommation énergétique, oui mais totale !
Fréquemment, lorsque l'on parle de consommation énergétique d'un bâtiment neuf, on fait référence à sa consommation sur les 5 usages de la réglementation thermique (RT) : le chauffage, les auxiliaires, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et la climatisation. La RT 2012 exige un niveau maximal pondéré pour ces consommations de 50 kWh/m²/an, exprimé en énergie primaire.
Mais le bâtiment a bien d'autres consommations énergétiques : en particulier les consommations non réglementées liées à la vie dans le bâtiment (électroménager, audiovisuel, bureautique, ascenseur, éclairage extérieur…) et l'énergie contenue dans les produits et équipements souvent appelée "énergie grise".
Comme le montre ce test, ces autres consommations sont loin d'être négligeables dans un bâtiment BBC puisque les usages réglementés représentent seulement 24 % de l'énergie primaire totale pour les bureaux et 37 % pour les maisons individuelles.
A noter :
- Pour un même bâtiment, réduire la durée de vie de 100 à 50 ans pour un même bâtiment, n'augmente que marginalement (entre 5 % et 10 %) ces consommations d'énergie primaire.
- 85 % à 95 % de la consommation d'énergie primaire totale sont non renouvelables.
Dans un bâtiment basse consommation, les usages "réglementés" représentent seulement 24 % de l'énergie primaire totale pour les bureaux et 37 % pour les maisons individuelles.
Indicateur : consommation énergétique totale en kWh/m2 shon/an
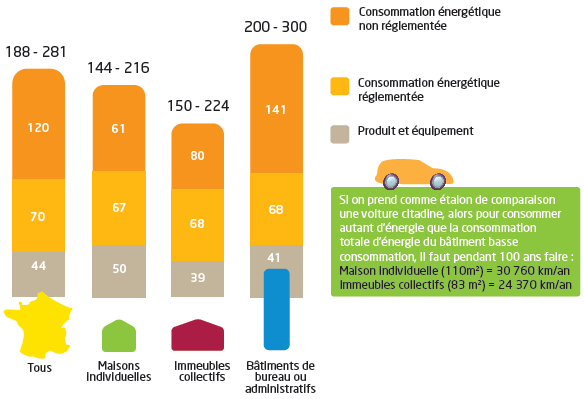
Emission de Gaz à Effet de Serre
Bien que l'indicateur s'exprime en kilogramme équivalent CO2, c'est bien l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique qui a été évalué : dioxyde de carbone (GES), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N20), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6). L'indicateur changement climatique traduit principalement l'impact des sources d'énergies utilisées (électricité, gaz, réseau de chaleur...) et donc doit être lu en association avec l'indicateur des déchets radioactifs marqueur de la consommation d'électricité fournie par le réseau.
Les produits et équipements de construction sont la principale source de GES du fait de certaines phases de leur cycle de vie, notamment le procédé de fabrication et le transport. Ils pèsent au moins pour la moitié des émissions. A contrario, ils sont très minoritaires pour les déchets radioactifs.
À noter :
- Le peu d'écart entre les différents bâtiments dans le résidentiel au niveau de l'impact GES des produits et équipements de construction montre que les systèmes constructifs étudiés ici, bien que très variés, se valent. Plusieurs leviers pour baisser leurs émissions de GES sont disponibles : innovation des produits, des systèmes constructifs eux-mêmes et surtout démarche globale de la conception des bâtiments.
- Le poids plus important en CO2 dans la consommation d'énergie réglementée des immeubles collectifs traduit une source énergétique moins électrique que pour les autres
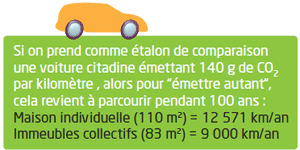
Indicateur : émissions de gaz à effet de serre en kgeqCO2/m2 shon/an
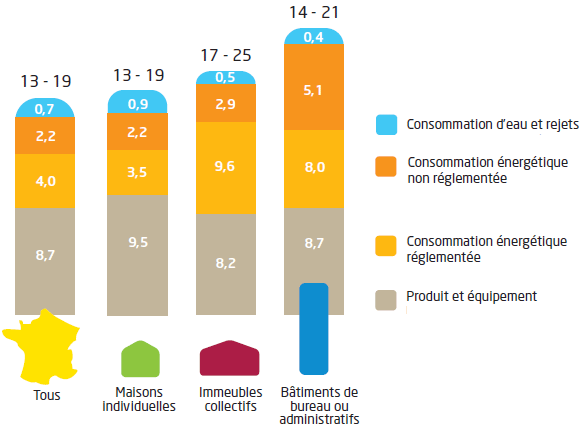
Les produits et équipements de construction pèsent au moins pour la moitié des émissions de GES
Contenu CO2 des sources d'énergies pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (en kg eq CO2)
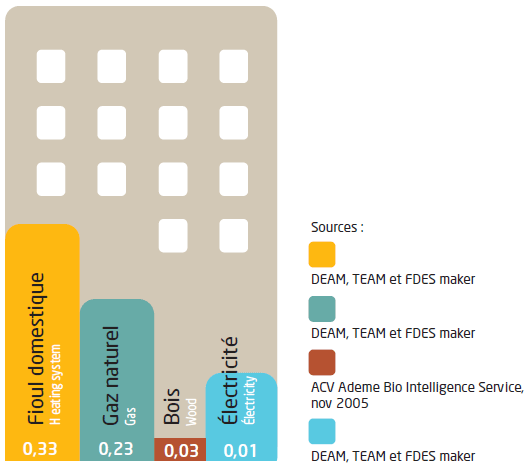
Les déchets
Les déchets sont classés en trois catégories réglementaires :
- les déchets inertes : béton, terre cuite, carrelage, verre et plus généralement les déchets de matériaux minéraux non pollués…
- les déchets non dangereux : la majorité des déchets des produits de construction de second oeuvre, les emballages des produits de construction, déchet métallique...
- les déchets dangereux : emballages de peintures souillés, huiles, solvants, certains bois traités…
Déchets inertes
Les produits de construction sont un levier d'action essentiel pour travailler sur cet indicateur.
En effet, ils représentent au minimum 70 % de la production de déchets inertes. Cela est dû notamment au scénario de "fin de vie" du bâtiment : sa déconstruction complète au bout de 100 ans et une mise en décharge intégrale des déchets inertes.
Bien évidement, plus la durée de vie du bâtiment est longue, plus la production de déchets inertes générés, essentiellement par les matériaux de structure, est lissée dans le temps.
Les produits de construction représentent au moins 70 % de la production de déchets inertes du bâtiment.

Indicateur : production de déchets inertes en kg/m² shon/an
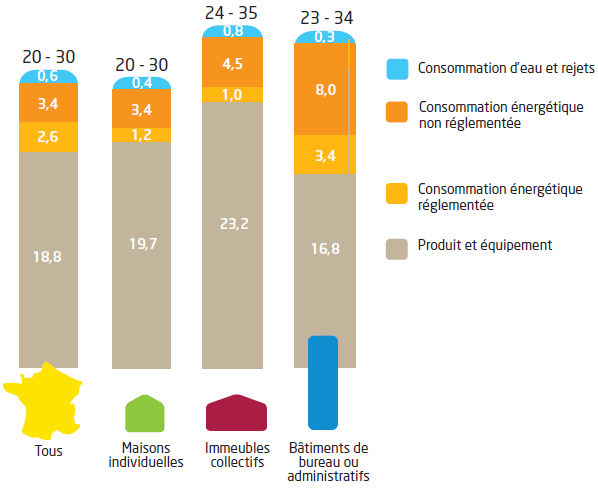
La consommation d'eau
L'indicateur consommation d'eau à l'échelle du cycle de vie du bâtiment est dû à 89 % à la consommation d'eau pendant la vie du bâtiment.
Toutes typologies confondues, l'indicateur consommation d'eau à l'échelle du cycle de vie du bâtiment est dû à 89 % à la consommation d'eau pendant la vie du bâtiment. Le scénario de consommation d'eau pour la phase de vie du bâtiment pèse donc considérablement sur cet indicateur.
Indicateur : consommation d'eau en L/m2 shon/an
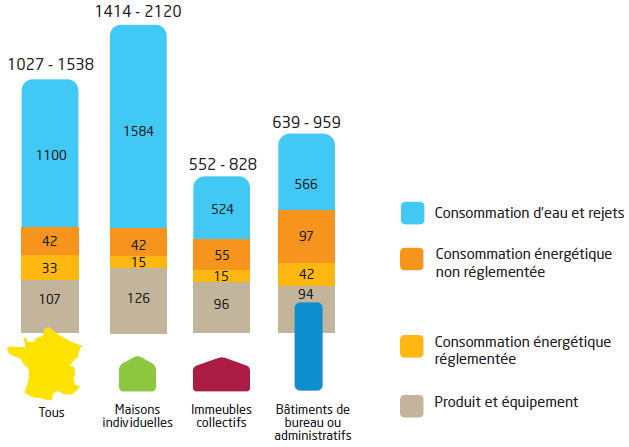
La Qualité d'Air Intérieur
Quatre opérations ont fait l'objet d'une mesure de qualité de l'air intérieur (QAI) dans le cadre du test HQE Performance 2011 entre mars et août 2011 :
- un immeuble collectif,
- une résidence étudiante,
- une maison individuelle,
- un immeuble de bureaux.
Les mesures ont été réalisées selon les opérations par Atmo Franche-Comté, Atmo PACA et le Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris. Conformément au protocole HQE Performance établi pour la mesure de la qualité de l'air intérieur des bâtiments neufs, les polluants mesurés ont été les suivants : dioxyde d'azote, benzène, formaldéhyde, particules (PM 2,5 et PM 10), composés organiques volatils totaux et radon (pour les zones concernées).
Ce protocole a été défini notamment à partir de ceux utilisés pour la campagne "école" portée par l'OQAI.
Mémo QAI
Qualité de l'air intérieur pour les bâtiments neufs : valeurs sanitaires de référence pour une exposition long terme
Dioxyde d'azote (NO2)
40 μg.m-3
Etablies par l'OMS
Benzène
5 μg.m-3 : valeur repère
2 μg.m-3 : valeur cible pour 2015
Etablies par le Haut Conseil de la Santé Publique
Formaldéhyde
30 μg.m-3 : valeur repère
20 μg.m-3 : valeur cible pour 2014
10μg.m-3 : valeur cible pour 2019
Etablies par le Haut Conseil de la Santé Publique
Radon
400 Bq.m-3
Etablies par l'Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
COV Totaux
> 300 – 1000 μg.m-3 : pas d'impact spécifique, mais augmentation de la ventilation recommandée.
< 300 μg.m-3 : valeur cible
Etablies par la Commission - Hygiène de l'air intérieur – de l'Agence fédérale allemande pour l'environnement
Qualité de l'air intérieur, plusieurs facteurs à prendre en compte


Source des informations présentées dans la suite de ce chapitre : SQUINAZI F. - HQE PERFORMANCE - Mesure de la qualité de l'air intérieur des bâtiments neufs à réception - Retour d'expérience sur les campagnes de mesure - Dec. 2011.
De façon autonome, les acteurs de la construction ne savent pas vers qui s'orienter pour faire les mesures de qualité de l'air intérieur.
Sur les opérations étudiées, on constate dans la plupart des cas, que les valeurs mesurées de formaldéhyde, de benzène, de dioxyde d'azote, de monoxyde de carbone et de radon respectent les valeurs sanitaires repères actuelles. Néanmoins, bien que les tests aient été réalisés sur des bâtiments neufs avant occupation (et donc sans mobilier), la valeur cible pour le formaldéhyde de 10 μg.m-3, qui témoigne d'une très bonne qualité de l'air, n'est jamais atteinte.
Les tests montrent également des différences significatives entre les valeurs observées dans différents locaux d'un même bâtiment. Des causes potentielles ont été évoquées :
- nature de certains produits de décoration,
- qualité de l'air extérieur (proximité de voies de circulation automobile à fort trafic, station essence…),
- dysfonctionnement du système de ventilation.
Ces tests soulignent aussi l'impact positif de la ventilation sur les concentrations des polluants dans l'air intérieur des bâtiments. En effet, dans deux des quatre cas où il y avait un dysfonctionnement de la ventilation, la concentration des polluants à l'intérieur des locaux était beaucoup plus forte et les valeurs sanitaires repères alors non atteintes.
Dans un des cas, la ventilation a contribué aussi à l'entrée de polluants d'origine extérieure (les indicateurs choisis étant le benzène et le dioxyde d'azote). Ce constat nécessite d'étudier, en amont de la construction d'un bâtiment, l'impact de la pollution extérieure et de mettre en oeuvre des solutions adaptées afin de lutter contre la pénétration des polluants d'origine extérieure.
Ces tests montrent la faisabilité du protocole établi par l'Association HQE pour la plupart des polluants recommandés : formaldéhyde, benzène, dioxyde d'azote et radon. La mesure des particules et des COV "Totaux" a posé problème quant à son mode de mesure (disponibilité des appareils de mesure recommandés…).
Si la planification d'une campagne de mesure de la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment neuf "à réception" peut-être pensée comme difficile à mettre en oeuvre, le test a prouvé que cela était possible. Les mesures ont été menées dans des locaux inoccupés et représentatifs du bâtiment étudié.
C'est là une pratique opérationnelle intéressante.
Enfin, dans le cadre du test, l'Association HQE, s'appuyant sur le réseau des AASQA (Agences agréées de surveillance de la qualité de l'air), a pu proposer aux participants des contacts pour faire les mesures. Mais, il est certain que de façon autonome les acteurs de la construction ne savent pas vers qui s'orienter pour faire ce type de mesures et que la plupart des laboratoires n'ont pas encore à disposition le matériel nécessaire.
Par Anne Sophie PERRRISSIN FABERT
Anne Sophie PERRRISSIN FABERT est directrice de l'association HQE.
Pour obtenir le document HQE PERFORMANCE « Premières tendances pour les bâtiments neufs »
HQE PERFORMANCE
SOURCES & LIENS
A propos de l'Association HQE
Plateforme de la construction et de l'aménagement durables reconnue d'utilité publique, l'Association HQE accompagne les donneurs d'ordres, professionnels, experts et usagers pour :
Pour ce faire, elle propose et fait évoluer des cadres de référence, mutualise les connaissances, forme les professionnels et incarne ses valeurs auprès des réseaux et instances tant nationaux qu'internationaux. Forte d'un savoir-faire de plus de 15 ans, l'Association HQE a créé, porte et décline la démarche HQE.
- Anticiper et initier la réflexion
- Contribuer au développement de l'excellence dans les territoires et pratiques professionnelles
- Porter l'intérêt général du secteur à l'international au travers de France GBC



