Interlocuteur des pouvoirs publics sur les questions relatives au Bâtiment, l'association Equilibre des Energies (EdEn) prend aujourd'hui position sur la future Réglementation environnementale des bâtiments neufs – RE2020 – qui est actuellement en cours de discussion.
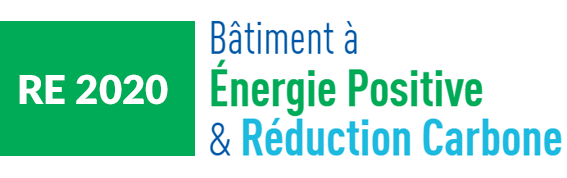
A la suite des premiers retours de l’expérimentation E+C-, les pouvoirs publics ont fait part de leur
intention de s’orienter, pour la future réglementation thermique environnementale des bâtiments
neufs, vers un système réglementaire fondé sur un socle associant un critère E (Energie) à un critère
C (Carbone), socle complété par l’obligation d’acquérir un minimum de « points » qui pourraient être
obtenus par un approfondissement des performances, soit dans le domaine de l’énergie, soit dans
celui des émissions de CO2.
Si cette organisation d’ensemble devait être retenue, il est impératif que les
critères adoptés ainsi que leurs modalités d’évaluation, soient définis en cohérence avec les critères
et objectifs de la LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte) et de la SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone).
1. Principes généraux
- une réduction de moitié des consommations d’énergie finale nationales par rapport à la référence de 2012 ;
- une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre nationales par rapport à leur niveau de 1990, complétée dans le Plan climat de juillet 2017 par un objectif de neutralité carbone au même horizon.
EdEn n’est pas hostile à l’introduction d’une certaine souplesse laissant le choix d’un approfondissement soit en direction du critère Energie (E) soit en direction du critère Carbone (C).
Cependant, elle appelle l’attention des pouvoirs publics sur la complexité du système et sur le risque, faute d’un recul suffisant, de voir une voie privilégiée par rapport à l’autre, avec pour conséquence de s’écarter fortement des trajectoires souhaitées et des objectifs visés. En conséquence, il lui parait préférable de réserver au « socle » le statut d’obligation réglementaire et de sanctionner les approfondissements venant en complément par des labels de caractère volontaire.
Bien entendu, après une période d’observation de quelques années, les labels pourraient être insérés dans la partie réglementaire selon des dispositions à déterminer le moment venu.
2. Socle réglementaire
- par le critère (E), mieux prendre en considération la qualité intrinsèque du bâti, quelle que soit l’énergie de chauffage utilisée ;
- par le critère (C), encourager le recours à des solutions sobres en émissions de CO , à la construction comme en exploitation.
Ce faisant, il faut bien entendu limiter les surcoûts de la construction à ceux que les gains en exploitation permettent d’amortir dans des délais acceptables.
Socle Energie (E)
- Le critère principal à retenir dans le socle au titre de l’énergie doit être le critère « consommation d’énergie finale », critère qui incite à une bonne isolation des bâtiments, est en rapport direct avec les consommations observables2 et évite les déviations liées à l’usage de l’énergie primaire. Bien entendu, si la prééminence à donner à l’énergie finale en tant que critère (E) vaut pour le neuf, elle vaut aussi pour l’existant dont la réglementation devra évoluer en conséquence ;
- La RT2012 exige une excellente performance énergétique des constructions. Aller au-delà des niveaux imposés aujourd’hui, y compris pour les logements collectifs bénéficiant de la modulation dite des 15 %, n’aurait pas de rentabilité économique et pourrait conduire à une détérioration de la qualité de l’air intérieur du fait d’un sous-dimensionnement de la ventilation ;
- Les cinq usages de la RT2012 et les outils informatiques de la RT2012 pour les évaluer peuvent être conservés pour calculer la consommation d’énergie finale, étape incontournable du calcul conventionnel actuel en énergie primaire. Cependant, il est désormais indispensable d’introduire dans ce calcul l’impact de la mise en œuvre des techniques de régulation avancée et de gestion active de l’énergie. Le gain attendu de la combinaison de ces techniques est estimé, pour les solutions électriques, à 30 % de la consommation d’énergie liée au chauffage. Il pourrait être introduit dans la réglementation, soit par un aménagement des modèles, soit de façon forfaitaire, sous forme d’un abattement de 30 % appliqué aux seules consommations liées au chauffage ;
- S’il était jugé nécessaire de maintenir, à titre transitoire, un critère fondé sur l’énergie primaire pour assurer la continuité avec la RT2012 ou pour répondre à une exigence des directives européennes, la base de 50 kWh/m2.an, majorée de 15 % dans le collectif, ne peut être conservée en l’état que si les trois conditions suivantes sont satisfaites, sauf à pérenniser le handicap infligé par la RT2012 aux solutions électriques :
- facteur de conversion du kWh électrique en kWh d’énergie primaire ramené de 2,58 à 2,0 comme l’a proposé la Commission européenne ;
- prise en compte de la régulation avancée et de la gestion de l’énergie dans les consommations conventionnelles de chauffage, selon un calcul forfaitaire consistant à accorder, pour les solutions électriques un crédit de 7 kWh/m2.an (correspondant aux 30 % d’économie sur le chauffage cités précédemment) ;
- mise en œuvre de la modulation carbone pour toutes les énergies distribuées par un réseau, à l’instar des dispositions prévues dans la RT2012 mais activées seulement pour les réseaux de chaleur.
- Il serait souhaitable que le socle impose l’établissement d’un bilan en énergies renouvelables, établi selon les règles européennes de décompte des énergies renouvelables, prenant en compte :
- la production locale d’électricité d’origine solaire effectivement consommée par le bâtiment selon un calcul au pas horaire prenant en compte, avec un facteur incitatif, la présence éventuelle d’un système de stockage ;
- les énergies renouvelables contenues dans les énergies apportées par les réseaux (électricité, gaz et chaleur) ;
- les prélèvements d’énergie thermique sur l’environnement par les pompes à chaleur et/ou par géothermie.
Socle Carbone (C)
- le calcul du CO2 contenu dans la construction est complexe. Il comporte encore beaucoup d’incertitudes amenant à des évaluations forfaitaires et parfois des erreurs importantes. In fine, le résultat est aujourd’hui peu discriminant. Les méthodes progresseront à l’avenir mais à un rythme nécessairement lent ;
- intégrer dans un indicateur global les émissions à la construction et en exploitation conduit à diluer l’importance de ces dernières en les immergeant dans un ensemble aux contours flous, compte tenu notamment des débats que l’on peut avoir sur la durée de vie des logements et leur devenir en fin de vie et sur les émissions importées et les fuites de carbone ;
- il n’y a pas de correspondance entre l’indicateur (C) actuel et les objectifs de la SNBC, les émissions à la construction relevant, comme rappelé précédemment, du secteur « Industrie » alors que les émissions en exploitation relèvent majoritairement du secteur « Bâtiment » ;
- il semble par ailleurs que dans le calibrage retenu pour l’expérimentation E+C-, les seuils de niveau 1 fixés pour la construction soient trop astreignants et soient à l’origine de coûts additionnels significatifs.
En conséquence, EdEn propose que deux critères distincts mais complémentaires aient à être satisfaits au titre du socle :
- un critère « Emissions à la construction » qui devra être simplifié pour admettre notamment des évaluations par type de bâtiments et des évaluations groupées pour les maisons individuelles identiques, sans pénaliser les solutions innovantes permettant de baisser significativement les émissions en exploitation ;
- un critère « Emissions en exploitation » fondé sur les émissions directes qui devront être calculées en intégrant les émissions associées aux divers intrants énergétiques : gaz, électricité et réseaux de chaleur, chacun étant traité selon des principes identiques.
Il est à noter que cette façon de procéder permet d’assurer la cohérence entre bâtiments neufs et bâtiments existants, ces derniers ne pouvant être concernés majoritairement que par le critère « Emissions en exploitation », la part « Emissions en construction » restant très faible en cas de rénovation.
Les niveaux minimaux requis par le socle « Carbone » devront, comme pour le socle « Energie » permettre de tendre le plus rapidement possible vers des bâtiments conformes aux objectifs carbone de la SNBC. Un alignement sur les exigences actuelles du niveau C1 serait à cet égard insuffisant et un resserrement du seuil minimal à atteindre semble justifié.
3. Niveaux additionnels
Généralités
L’individualisation des deux critères permettra de mieux les faire comprendre par le public. Cependant le risque existe de voir les parties prenantes privilégier l’un d’entre eux, au motif qu’il serait considéré comme plus facile à satisfaire, aux dépens du deuxième qui se trouverait alors « enkysté » dans un niveau inférieur. En conséquence :
- Les labels devraient être réservés à des bâtiments permettant de progresser d’au moins un niveau dans chacune des deux directions mais avec une répartition variable : 1+1, 1+2, 2+1, 2+2, etc.
- Une segmentation plus fine du critère (C) que celle de l’expérimentation E+C- est évidemment nécessaire pour assurer le parallélisme avec les niveaux (E) mais il n’est pas certain que quatre niveaux soient utiles : trois niveaux pour chacun des critères (E) et (C) pourraient être suffisants ;
- Ces niveaux devraient constituer des marqueurs du DPE après qu’il aura été revu afin de lui conférer une meilleure fiabilité. Bien entendu les deux critères émissions de CO2 et consommation d’énergie devraient à l’avenir être considérés avec la même importance dans les obligations d’affichage et être pris en compte à parité dans les mécanismes d’incitation financière ou réglementaire. Un nuancier de couleurs plus marquant que le nuancier actuel (allant par exemple du noir au vert clair) devrait être adopté pour le critère CO2.
- Les niveaux additionnels (E) viendront reconnaître des efforts supplémentaires menés pour réduire les consommations d’énergie. Il ne parait pas utile de maintenir pour cela le critère « énergie primaire » et ces niveaux additionnels pourraient être formulés uniquement en termes d’énergie finale. Les usages spécifiques autres que les usages réglementés pourraient entrer dans le calcul, s’il devient possible de les évaluer par des formules autres que forfaitaires ;
- Le bilan en énergie renouvelable évoqué précédemment pourra également constituer une condition de labellisation, reprenant le principe du ratio d’énergie renouvelable (RER) introduit dans l’expérimentation E+C- ;
- Il serait enfin envisageable d’introduire d’autres considérations telles que la présence de systèmes visant à limiter les puissances appelées sur le réseau électrique : stockage d’électricité, système de pilotage de la recharge des véhicules électriques voire systèmes bidirectionnels en V2G, gestion réactive de l’énergie produite localement. Cela pourrait se faire sous forme de bonifications dans l’appréciation du franchissement des seuils.
- Les niveaux additionnels relatifs aux émissions devront être calés de façon à paver la route vers le respect intégral des objectifs de la SNBC ;
- Comme pour l’énergie, la mise au point de ces niveaux doit être l’occasion de développer et de perfectionner des méthodes de détermination des émissions en cycle de vie, intégrant les matériaux et les constituants, à la condition de bien distinguer ce qui ressortit des émissions en exploitation et des émissions liées à la construction.
Niveaux additionnels Energie
Niveaux additionnels Carbone
Source et lien

10, rue Jean Goujon - 75008 Paris - France
T. +33 (0)1 53 20 13 70
info(a)equilibredesenergies.org
L'association Équilibre des Énergies (EdEn) est une plateforme transversale qui fédère les acteurs du monde de l'Énergie, du Bâtiment et de la Mobilité, autour d'un projet commun : Construire une société Énergétique meilleure. Elle regroupe des institutionnels, des associations, des syndicats, des fédérations professionnelles, des grands groupes, des TPE, des PME et des artisans. L'objectif premier de ses membres, qui appartiennent au tissu économique français, est de favoriser les solutions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi EdEn porte l'innovation et l'excellence industrielle de la France au cœur de son discours.

