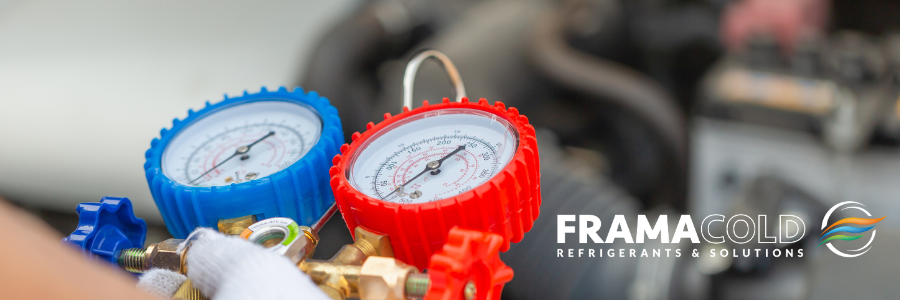Par Roger CADIERGUES le 04 Juillet 2019
2 juin 2008
J'ai déjà agité ce sujet dans ma lettre du 7 Avril, qui était précédée de la description d'un exemple britannique (lettre du 31 Mars). En fait, que ce soit conscient ou non de la part des décideurs locaux, que les gouvernements aient bien compris l'importance de la question ou pas, restera toujours une ambiguïté sous-jacente : faut-il, ou non, décentraliser les productions de chaleur et d'électricité. Et, surtout, quelles en sont les conséquences financières ?
S'agit-il d'un problème technique ou d'un problème économique ?
Economique pour l'essentiel bien entendu, si l'on exclut les idées utopiques. Ce sont surtout les énergies dites renouvelables que l'on tente de décentraliser, mais l'affaire se termine souvent autrement. Avec deux conséquences pour les coûts : pour l'Etat d'une part, pour l'usager final d'autre part. Dans les conditions françaises actuelles le coût public est essentiellement lié au crédit d'impôt. Celui-ci devrait, en 2008, atteindre près de 3 milliards d'euros, une ponction budgétaire qui n'est évidemment pas négligeable.
S'agit-il vraiment d'une incitation à la localisation énergétique ?
Pas vraiment. Sans qu'on puisse garantir que les ratios resteront toujours identiques, si l'on se base sur les statistiques 2006, et si l'on exclut les chaudières "basse température" (qui devraient disparaître de ces crédits en 2009) la répartition des aides est la suivante : 45% pour le bois et la biomasse, 27% pour les pompes à chaleur, 17% pour le solaire thermique, 11% pour les chaudières à condensation. Cela situe assez bien les efforts actuels, qui portent pour presque moitié sur l'utilisation de la biomasse (sur laquelle je reviendrai), dont on comprend bien qu'elle est par nature locale. Pour ce qui concerne les pompes à chaleur et les chaudières à condensation il ne s'agit pas vraiment de décentralisation. La seule exception est le solaire thermique, qui sert surtout à alimenter des services d'eau chaude. Dans ce cas on ne peut pas, à proprement parler, dire qu'il s'agit de localisation.
Alors pourquoi parlez-vous de centralisation (ou de décentralisation) des productions ?
Parce qu'une initiative réglementaire, présentée comme une application des directives européennes, relance le sujet : il s'agit de l'arrêté du 18 Décembre 2007 intitulé "Etude de faisabilité technique et économique des approvisionnements en énergie des bâtiments neufs ou existants …". Cet arrêté oblige à fournir, dès la demande de permis de construire, une étude technico-économique évaluant l'intérêt de solutions locales : solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, bois et biomasse, pompes à chaleur, chaudières à condensation, productions combinées, et raccordement à un réseau. Une telle étude, au niveau de la demande de permis de construire, est fortement incohérente au plan français où la demande de permis reste techniquement modeste en contenu. C'est donc une réforme profonde du permis de construire, qui ne me semble pas avoir été vraiment réfléchie. En fait, il y a plus, car l'exigence couvre des caractéristiques très variables des différentes techniques qui sont envisagées. Comme une seule technique doit, en toute rigueur, faire l'objet d'un examen, il est vraisemblable que les choix seront totalement biais par rapport aux intentions initiales des rédacteurs de l'arrêté (peut-être d'ailleurs était-il seulement nécessaire de satisfaire une obligation européenne).
Qu'entendez-vous par là ?
L'arrêté oblige à choisir, pour l'étude de faisabilité, entre des options qui relèvent finalement de deux cadres très différents. Alors que l'un est relativement simple, l'autre est beaucoup plus douteux et complexe, ce qui devrait conduire à ne jamais s'orienter (du moins au niveau du permis de construire) vers le deuxième cadre. Voici ce dont il s'agit. Le premier cadre s'intègre normalement dans les études allant plus ou moins de soi dans les pratiques actuelles, mais ceci bien après le permis de construire, car il concerne les techniques relevant de choix circonstanciés qui dépendent fortement des études finales : le solaire thermique, le bois (ou la biomasse), les pompes à chaleur, les chaudières à condensation, la production combinée, le raccordement à un réseau éventuel. Alors que le deuxième cadre prévu par l'arrêté couvre ouvertement des choix délibérés de décentralisation (solaire photovoltaïque ou éolien). Bien qu'à mon avis les études de faisabilité (pour des raisons de commodité) aient de grandes chances de ne jamais concerner cette deuxième catégorie, il s'agit clairement de savoir si on centralise ou décentralise la production d'électricité. C'est là une discussion qui n'a jamais eu lieu dans notre pays. Et qui vaudrait pourtant un examen sérieux. Lequel serait, à mon avis, très défavorable à la décentralisation, sauf cas exceptionnel. De toutes façons, que les installations de production photovoltaïques ou éoliennes d'électricité, soient centralisées ou décentralisées, les bilans sont - dans ces deux cas - inquiétants : nous y reviendrons la prochaine semaine.
Roger CADIERGUES