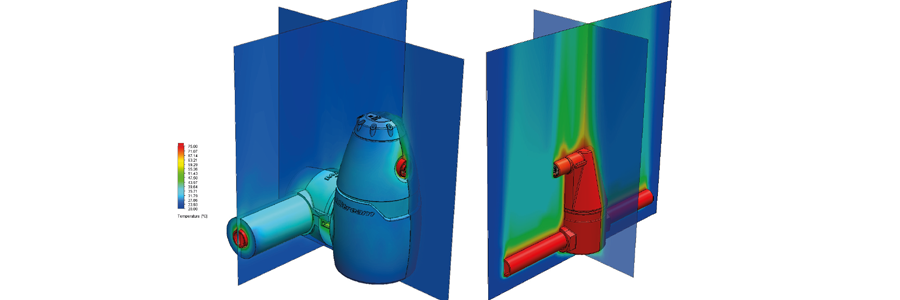Par Alain MAUGARD, président de QUALIBAT le 04 Juillet 2019
Il faut désormais se pencher plus avant sur le cas des « zones oranges et rouges » dans l’hypothèse désormais très vraisemblable de la percée des ENR locales.
Une toute dernière étude de l’ADEME considère comme hautement probable l’arrivée en 2020-2021 de la parité de l’électricité photovoltaïque sur les surfaces de toits de quelques m² ; en tout cas, très sûrement, dans le Sud de la France et les régions ensoleillées. Dès lors, ce que nous appelons « la récolte des photons » sur les toits se fera naturellement par des mécanismes financiers qui n’auront plus à bénéficier d’aides de l’Etat.

1/ Les gens seront donc libres de récolter ces photons
Si l’on continue cette comparaison agricole, rien ne pourra empêcher qu’ils récoltent la quantité nécessaire à leur consommation. En revanche, s’ils décident d’avoir des excédents, il faudra qu’ils trouvent preneurs pour cette électricité excédentaire.
En affinant l’analyse, même dans le cas où la production couvre juste la consommation, il n’y a pas forcément concomitance entre les périodes de production et les périodes de consommation. Pour aller dans ce sens, il faut donc essayer de rendre synchrone la consommation avec la production.
Cela conduit, d’une part, à des différés de consommation (par exemple, gestion des appareils ménagers, gestion des heures de fonctionnement des appareils électroménagers).
Cela conduit aussi à stocker la production électrique ; pour cela, il y a deux pistes possibles complémentaires ;
- La première consiste à transformer la production électrique en chaleur et stocker la chaleur (c’est le cas du chauffe-eau électrique qui, du coup, pourrait retrouver un regain d’intérêt) ;
- La seconde consiste à stocker l’électricité elle-même dans des batteries. Cette dernière solution, qui jusqu’à maintenant, semblait très onéreuse a désormais des horizons de baisses des coûts très significatifs (les dernières propositions de la firme TESLA semblent marquer un tournant décisif en proposant des prix inférieurs à 5 000 euros).
2/ Vers l'autonomie énergétique électrique des bâtiments
En poussant jusqu’au bout ces deux pistes, il est envisageable d’atteindre l’autonomie énergétique (électrique) des bâtiments. Ce qui résout notre problème de branchement sur les réseaux.
Mais, le cas le plus fréquent, restera un régime en trois temps : une période pendant laquelle la production sera insuffisante au regard de la consommation et il faudra donc apporter de l’électricité ; une période où production et consommation s’équilibreront ; une période où la production sera supérieure à la consommation.
Vis-à-vis du réseau, il importe de situer dans le temps les périodes d’importation et les périodes d’exportation dans l’optique d’une gestion globale optimisée des réseaux. La meilleure façon de le faire serait d’avoir des tarifs, variables en fonction du temps t pour l’importation, et variables en fonction du temps t pour l’exportation. Au regard de ces tarifs intelligents, les occupants de bâtiment optimiseraient la gestion énergétique des bâtiments.
On pourrait aussi limiter les puissances installées et donner un avantage tarifaire aux très petites puissances.
3/ Nous rentrons dans le jeu malin des « bâtiments responsables » vis-à-vis du réseau
Le bâtiment n’est pas isolé, il est dans un territoire et les besoins d’exportation nette d’électricité produite par le bâtiment seront différents en fonction des structures de consommation de ces territoires et des possibilités de production de ces mêmes territoires.
De plus, à l’échelle de territoire, nous pouvons compter sur un foisonnement des consommations des bâtiments et sur un foisonnement des productions de bâtiment ; ce qui conduit à ce que l’autoconsommation, à l’échelle du territoire, soit supérieure à la somme des autoconsommations des bâtiments qui le constituent. De façon générale, l’autonomie collective sur le territoire sera plus facile à atteindre que l’autonomie individuelle.
Dans un scénario post 2020 dans lequel « la récolte des photons » se généralise, il faudra envisager de l’affecter, non seulement à toutes les consommations du bâtiment (consommation d’électricité domestique comprise) mais aussi aux transports par véhicule électrique (individuel ou collectif). Ce véhicule, d’ailleurs, pouvant contribuer à stocker l’énergie électrique et donc assurer une plus grande synchronisation entre la production et la consommation électrique.
Toujours dans ce scénario, certains commencent à dire qu’il ne serait plus nécessaire de mettre les panneaux photovoltaïques sur les surfaces les plus exposées au soleil mais utiliser d’autres parois de l’enveloppe donnant ainsi des souplesses architecturales bienvenues. On pourrait aussi envisager de piloter les onduleurs, de façon à « maîtriser » la production électrique.
Jouer avec le réseau, c’est donner une manœuvrabilité énergétique importante au bâtiment et, comme nous l’avons vu, cela passe par une manœuvrabilité de la période d’autoconsommation et par la possibilité de stockage (sous la forme chaleur et sous la forme électrique) et certainement aussi pour assurer une plus grande résilience par des solutions hybrides fondées sur l’ajout de la biomasse ou du biogaz.
Alain Maugard