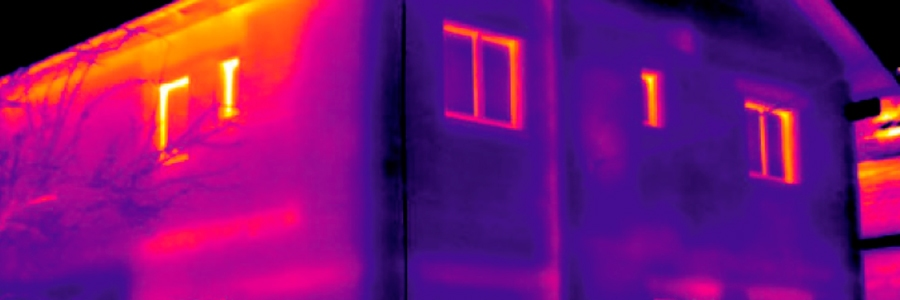Par Bernard SESOLIS, expert Energie Environnement le 04 Juillet 2019
Ce n’est pas une nouvelle fable de La Fontaine, mais une réalité. A Varsovie, du 11 au 22 Novembre 2013 a lieu la 19ème conférence de l’ONU sur le changement climatique. A l’heure où j’écris ces quelques humeurs, les décisions qui seront prises au terme de cette nouvelle réunion internationale ne sont pas connues. Mais je fais le pari stupide et sans grand risque que la montagne d’actions nécessaires pour limiter les futures catastrophes climatiques va encore accoucher d’une souris. Et ceci, malgré la publication du dernier rapport du GIEC de Septembre, encore plus alarmant que les précédents.
L’Organisation Mondiale de Météorologie (OMM), agence de l’ONU à Genève, confirme que les émissions en 2012 ont atteint de nouveaux records : + 0,56% pour le dioxyde de carbone, +0,33% pour le méthane et +0,28% pour le protoxyde d’azote. Le secrétaire général de l’OMM, Michel Jarraud, rappelle durement qu’ « aucune décision n’a été prise pour arrêter cette tendance à la hausse ».
Décidemment, je ne parviens pas à m’échapper de cette actualité pour axer mes humeurs sur des questions plus opérationnelles. Je le ferai.
Mais pour l’instant, quelques articles récents méritent encore d’être rappelés ici.
Le sud et le nord responsables à part égale … en émissions de gaz à effet de serre (GES)
Dans le Monde du 06/11/13, Pierre Le Hir évoque une étude du PBL Netherlands Environmental Assesment Agency qui met en évidence un basculement historique : les émissions cumulées de GES des pays en développement depuis 1850 sont en passe de dépasser celles des pays développés.
En 2010, les « pays riches » représentaient 52% des émissions totales (dont USA = 18,6%, Union Européenne = 17,1%, Russie=7,2%, Japon=2,8%). Les 48% du reste du Monde étaient principalement dus à la Chine (11,6%), l’Indonésie (4,8%), l’Inde (4,1%) le Brésil (3,9%).
Le record de 34,5 milliards de tonnes de CO2 émis en 2012 représente une hausse de 1,1% par rapport à 2011. Il s’agit néanmoins d’un ralentissement de la hausse au regard de sa moyenne durant la dernière décennie. Une sorte de pause car l’économie mondiale a parallèlement enregistré une croissance de 3,5%. Les auteurs de l’étude traduisent ce phénomène par un recours accru aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie.
Mais l’optimisme n’est pas à l’ordre du jour. La Chine pèse maintenant 29% des émissions de GES pour 16% aux USA et 11% en Europe. Les Etats-Unis ont réduit leurs émissions de 4% grâce au … gaz de schiste moins carboné que le charbon et ils vont redevenir exportateur de pétrole … L’Europe a fait un effort se limitant à -1,6% d’émissions. Quant à l’augmentation de 3% des émissions du géant chinois, elle est bien inférieure à sa moyenne annuelle de +10% au cours de la dernière décennie due à son très fort taux de croissance mais néanmoins en tassement.
Les efforts des chinois sur l’hydro-électricité (avec les impacts environnementaux très négatifs sur le terrain) et leur propension à acheter de la technologie électronucléaire atténueront peut-être leur gourmandise en charbon.
Justement, en évoquant le nucléaire, la réflexion qui suit vient en écho sur le mode de production d’électricité.
Réduire le gigantesque gâchis pour l’électricité
Enfin, on évoque la gabegie de la production d’électricité ! Je passe mon temps à rappeler que 2kWh sur 3 utilisés dans les centrales électriques chauffent les poissons et les oiseaux. Dans son article du 30/10/2013 « Et si on testait le chauffage nucléaire », Pierre Le Hir (encore lui !) reprend à la lettre ces mots. Et, ce qui est dit ici du nucléaire est vrai pour toutes les centrales classiques.
Il cite Henri Safra de la direction scientifique du CEA qui avance que la chaleur non exploitée des 58 centrales nucléaires françaises pourrait chauffer toute la France ! Pourtant, les quelques exceptions (alimentation pour l’horticulture à Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre ou Saint Laurent, alimentation de quelques bâtiments à Golfech ou à Gravelines), confirment la règle : actuellement, aucune volonté pour mettre en œuvre de la cogénération.
Est-ce technologiquement difficile ? Il semblerait que ce problème est largement surmonté. 74 des 432 réacteurs nucléaires de la planète fournissent massivement de la chaleur, notamment dans les pays de l’Europe de l’Est qui sont culturellement très attachés aux réseaux de chaleur. Au Japon et en Inde, la cogénération s’applique au dessalement de l’eau de mer.
Deux exemples en Tchéquie : La ville de Tyn (8 000 habitants) est alimentée en chaleur à 75% par la centrale de Temelin située à proximité. Les habitants payent leur chauffage 20% de moins que le reste du pays. Du coup, la ville de Ceské Budëjovcice (100 000 habitants) à 24 km de Temelin met en place une infrastructure identique.
EDF considère qu’une telle stratégie supposerait trop d’études et qu’il vaut mieux s’attacher à mettre tous les moyens financiers dans de nouveaux moyens de production ! C'est-à-dire tenter d’augmenter d’hypothétiques rendements plutôt que d’exploiter sûrement d’énormes rejets existants …
Henri Safra considère que la rentabilité d’une telle démarche est pourtant établie. 100 km de réseau ne génèreraient que 2% de pertes de chaleur. La moitié du chauffage et de la production d’ECS pourrait être assurée avec 20 milliards d’euros d’investissement et un retour sur investissement de 2 ans grâce au pétrole substitué ! Cette piste de la cogénération à grande échelle a été abordée durant le débat national sur la transition énergétique. EDF est paradoxalement rejoint par la porte parole du réseau Sortir du nucléaire, Charlotte Mijeon, qui voit un danger supplémentaire d’incitation à consommer une énergie devenue finalement peu chère … Un effet « rebond » conduisant à de nouveaux gaspillages.
J’avais abordé la question du « rebond » en Mars 2013. J’y reviendrai de manière plus concrète dans un prochain article car elle est, à mon sens, primordiale. Et justement, un autre article du Monde daté du 05/11/2013 traite ce sujet et raisonne avec un article sur le gaspillage alimentaire mondial évoqué dans mon humeur du mois dernier.
« La face cachée de la vertu »
C’est ainsi que les trois auteurs, Sophie Clot (Université Montpellier I/Lameta), Gilles Grolleau (Groupe ESC Dijon), Lisette Ibanez (INRA) intitulent leur article avec un sous-titre évocateur : Consommation durable et hypocrisie morale.
Leur propos concerne la question du comportement vertueux. Les auteurs constatent en s’appuyant sur plusieurs études récentes que nous exerçons inconsciemment ou non une « comptabilité morale » de nos « bonnes » et « mauvaises » actions.
Une sorte d’arbitrage interne qui consiste par exemple à se permettre de prendre un cornet de frites parce qu’on a opté pour un coca light, ou à effectuer plus de kilomètres parce qu’on roule dans une voiture hybride, ou encore à être moins attentif à sa consommation d’énergie parce qu’à la suite d’une campagne environnementale, la consommation d’eau a baissé. J’ajouterais l’exemple bien connu consistant à laver sa voiture à l’eau chaude puisque la maison est équipée d’un capteur solaire.
Cette compensation morale fonctionnerait dans les deux sens : un bouquet de fleurs pour se faire pardonner, un don pour la banque alimentaire après avoir rempli à ras bord son caddy de victuailles pour Noël.
Et de conclure qu’en considérant un comportement de manière isolée, on peut se tromper et générer des phénomènes contre-productifs.
Atténuer des effets négatifs, provoquer une succession d’actions cohérentes et vertueuses, constituent pour les auteurs, à juste titre, un réel enjeu pour la mise en place de politiques publiques compatibles avec le développement durable.
Concevoir, construire des bâtiments vertueux d’un point de vue environnemental et sociétal est une évidente nécessité mais cela ne suffit pas. Faut-il encore que les occupants suivent … ou que les acteurs de la construction et de la réhabilitation cernent mieux ces « effets rebond ».
Bernard Sesolis
bernard.sesolis(at)gmail.com